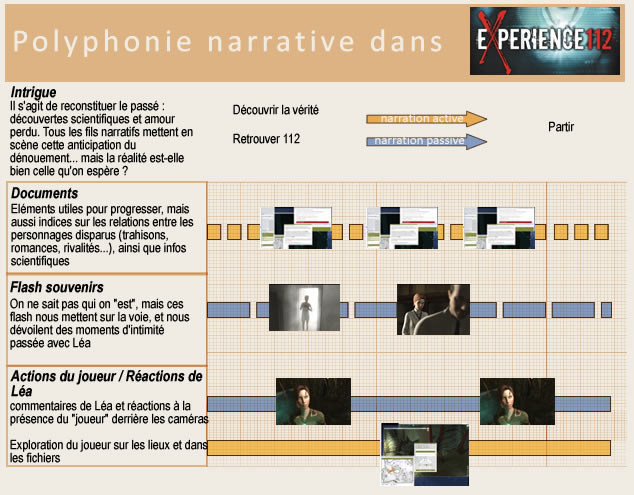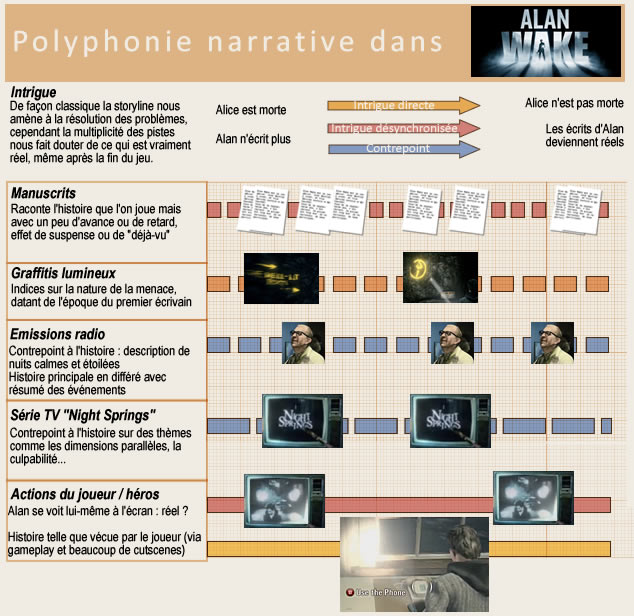[Attention, ce billet comporte de gros méga maxi spoilers sur Bioshock 2 (pour changer), et surtout sur Silent Hill : Shattered Memories et Heavy Rain]
Je ne sais pas si je suis biaisée par mon propre vécu, mais j’ai l’impression que le père divorcé est le héros à la mode ces temps-ci. Je me souviens d’avoir vu il y a longtemps le film « Mon père ce héros », avec Gérard Depardieu et Marie Gillain. Mes souvenirs en sont assez flous, je crois que ce n’était pas terrible. Mais j’avais été curieuse et contente à l’époque de pouvoir trouver au cinéma un reflet de mon expérience. Au final les péripéties du film étaient assez cliché, et très éloignées de ce que je pouvais vivre avec un père devenu un peu lointain.
Rien à voir avec ce nouveau héros des temps modernes sauveur du monde et de la famille : le père divorcé n’est plus un demi-loser à côté de ses pompes, c’est LE nouveau modèle masculin.
Pensez un peu :
Tom Cruise dans la version de Spielberg de La Guerre des Mondes. Père divorcé, il a un fils et une petite fille. Forcément il fait tout de travers, est en retard pour s’occuper d’eux, n’a rien dans les placards pour leur faire à manger, s’énerve et ne sait pas rassurer. Forcément les enfants sont distants et ne lui font pas confiance. Forcément quand survient la fin du monde, il est le seul à savoir quoi faire pour sauver leur peau à tous. Effusions, regards virils et mouillés, à la fin du film, les enfants kiffent leur paternel pour la vie.

Ben Stiller dans La Nuit au musée. Divorcé, au chômage, il essaie d’impressionner son fils avec son nouveau job au musée, mais ne part pas gagnant (il n’est que gardien de nuit). Le petit regarde son père avec désapprobation, déception, presque pitié. Il faudra que tout un musée prenne vie et se mue en parc d’attraction VIP, et que la ville soit menacée par un complot de méchants pas beaux, pour que le père puissé révéler quel aventurier sommeillait en lui… et regagner une admiration filiale bien méritée.

John Cusack dans 2012. Divorcé, écrivain et chauffeur pour gagner sa vie, un fils et une fille, même méfiance chez les enfants vis à vis des plans foireux de leur père. Et pourtant au moment où tout le monde est déphasé par la réalisation inopinée d’une soi-disant prophétie maya, il est le seul à bien réagir et faire ce qu’il faut pour procurer à sa famille des places sur l’arche salvatrice alors que le monde s’écroule. Même son ex le regarde avec reconnaissance.

Même genre de personnage dans Le Jour d’après (même si je crois pas qu’il était divorcé), ou dans Minority Report (sauf que le fils avait été tué). Tant de pères déchus puis à nouveau sacrés, dans tant de blockbusters, ça donne à réfléchir.
Le père divorcé, figure de l’homme fragile, portant une fêlure intérieure, un échec personnel, mais qui réussit à se reconstruire, à prouver sa valeur, à se poser à nouveau en « chef de famille ». A réaffirmer sa virilité tout en assumant sa sensibilité ? (oui je sais, on dirait du baratin de magazine féminin). Je pensais que c’était quelque chose de globalement admis, la capacité des hommes à assumer leur paternité, et à le vivre bien. Mais apparemment ça nécessite encore quelques catastrophes à échelle planétaire pour que la transformation en père épanoui s’opère (j’ai toujours été trop optimiste quant à l’espèce humaine).
Toujours est-il que cette épidémie de paternité héroïque semble passer de Hollywood au jeu vidéo. En l’espace de quelques mois, on a eu Bioshock 2, Heavy Rain et Silent Hill : Shattered Memories, trois gros titres dans lesquels le héros est un père solitaire à qui on arrache son enfant.

Dans Bioshock 2 on incarne un « big daddy », protecteur d’Eleanor Lamb, ex « little sister ». Je ne rappelle pas de quoi il s’agit, j’en ai déjà beaucoup parlé précédemment. Le jeu s’ouvre sur la scène de séparation entre le père et la « fille », emmenée par sa mère. Tout au long du jeu, la fille nous laisse des messages, elle appelle son père à l’aide, tandis que la mère tente de nous empêcher de la rejoindre. La mère explique que nous avons une mauvaise influence sur Eleanor, qu’elle serait mieux sans nous. Et effectivement nos actions déterminent la personnalité d’Eleanor et la fin du jeu. Pourtant il n’y a aucun lien de parenté entre elle et le protagoniste, le lien vital qui les relie a été fabriqué de toutes pièces. Mais Eleanor a tellement rêvé de ce père qu’elle en a fait le héros libérateur dont elle a besoin. Tous les actes du joueur sont alors commis en ayant cela en tête. Un scénario et une trame narrative qui soulèvent bien des questions sur la signification du lien biologique ou choisi, sur l’amour filial, sur l’influence des parents sur notre devenir moral et psychologique.
Cependant comme dans le premier Bioshock, les choix n’en sont pas vraiment, et dans tous les cas, on ne peut pas faire autrement que de sauver Eleanor, même quand le lien psychique qui nous y attachait est rompu. Le gameplay n’est pas allé au bout du questionnement formulé par le scénario. On peut en revanche devenir un héros positif ou négatif, dans tous les cas on reste un modèle pour notre progéniture adoptive.
Cet aspect du jeu, le thème de la paternité, a fortement influencé deux critiques, dont je recommande la lecture :
On my shoulder, whispering (The Brainy Gamer)
Who wants to be a Big Daddy? (Edge)

Dans Heavy Rain, le personnage principal est un père qui a perdu un premier fils dans un accident, et dont le second fils est enlevé par un tueur en série. Ethan devra accomplir une série d’épreuves plus ou moins atroces afin de prouver qu’il est prêt à tout pour sauver son fils. C’est en effet ce que requiert le tueur psychopathe, apparemment traumatisé par la mort de son frère quand ils étaient petits : son père alcoolique avait refusé de lui venir en aide. Il cherche depuis un père qui soit vraiment à la hauteur, capable de rattraper symboliquement les torts de son propre père.
Ethan est quant à lui dévasté par la culpabilité depuis la mort de son premier fils, il est maintenant divorcé, et a bien du mal à vivre la relation avec son autre fils. C’est ce que le jeu ambitionne de mettre en scène, ce manque, cette latence, à travers des scènes du quotidien. On joue ce père désaxé, qui n’a rien dans le frigo, qui essaie de dérider son fils en lui proposant de jouer. Scènes habituelles et déjà vues au cinéma, préambule du moment où le héros se révèle et sauve le monde (ou juste sa famille). Mais dans un jeu vidéo, on commence généralement là où il y a de l’action, quitte à s’émouvoir deux minutes pendant les cinématiques. C’est peut-être ce que Heavy Rain avait de plus réussi finalement, cette insistance sur l’anti-héroïsme du personnage, avec le gameplay qui va avec.
Si on se débrouille bien, le père sauve son fils, trouve une nouvelle copine, et tout le monde finit heureux dans un nouvel appartement, comme au cinéma. On peut aussi échouer comme une quiche, ou décider de fuir les épreuves, tant pis pour le gamin. Le joueur peut répondre de différentes façons aux injonctions du tueur, et ainsi réaliser – ou pas – cette héroïfication du père divorcé.

Dans Silent Hill : Shattered Memories (reboot du tout premier Silent Hill), on joue Harry Mason : il vient d’avoir un accident de voiture et sa fille, la petite Cheryl, a disparu. On part donc à sa recherche dans la ville fantôme de Silent Hill. On y croise des inconnus qui disent nous connaître, on y trouve des traces du parcours d’une adolescente livrée à elle-même, une certaine Cheryl… Cette Cheryl-là semble abandonnée par ses parents, elle vole, sort avec un homme qui pourrait être son père. A quelle époque est-on ? Que s’est-il vraiment passé ? A-t-on perdu la mémoire de plusieurs années ? Le mystère s’épaissit, les pistes se multiplient, d’autant que la trame de l’histoire est entrecoupée de séances chez un psy, vues en première personne, où l’on doit répondre à des questions sur le deuil, la sexualité, les parents, le divorce.
Au moment où on commence vraiment à douter de la capacité de Harry à être d’un quelconque secours pour sa fille disparue, le twist final vient bouleverser tout ce qu’on croyait avoir compris (si vous n’y avez pas joué, j’insiste, ne lisez pas la suite) : en réalité tout ce que nous avons joué se passait dans la tête de la jeune Cheryl. Harry, son père divorcé, est mort seul il y a longtemps dans ce fameux accident de voiture. Mais sa fille a continué à fantasmer ce père disparu : l’aurait-il aidé s’il avait été là ? Quelles femmes aurait-il rencontré ? Est-elle responsable de son départ et de sa mort ? Ou bien sa mère est-elle coupable ? Toutes ces angoisses et rêveries ont constitué la trame décousue du jeu, la thérapie de l’adolescente qui devait réussir à dire adieu à son héros de père divorcé. Finalement, d’une certaine façon, on réussit tout de même à la sauver : en menant cette aventure imaginaire, on la conduit à guérir de son traumatisme d’enfance et à reprendre sa vie. Le père divorcé, héros post-mortem : c’est sans doute l’une des plus belles versions du personnage.
Je trouve intéressante et très riche cette apparition du thème de la paternité dans le jeu vidéo. S’agit-il d’un stade de maturité que l’art aurait atteint (ou les gens qui bossent dans le métier qui se font vieux) ? D’un sentimentalisme masculin nouvellement assumé ? D’une manœuvre marketing pour attirer les filles tout en ayant l’air de rester viril ? (auquel cas je tiens à dire que ça ne marche pas sur moi).
Quoi qu’il en soit ces trois jeux proposent une vision bien moins consensuelle qu’au cinéma du personnage, bien moins unilatérale, et mettent en question la solidité réelle du lien père-enfants, ainsi que sa nature. Oui, pas longtemps et vite fait, mais quand même… :)
Qui sera le prochain père solitaire et quelle sera sa mission ? A suivre…